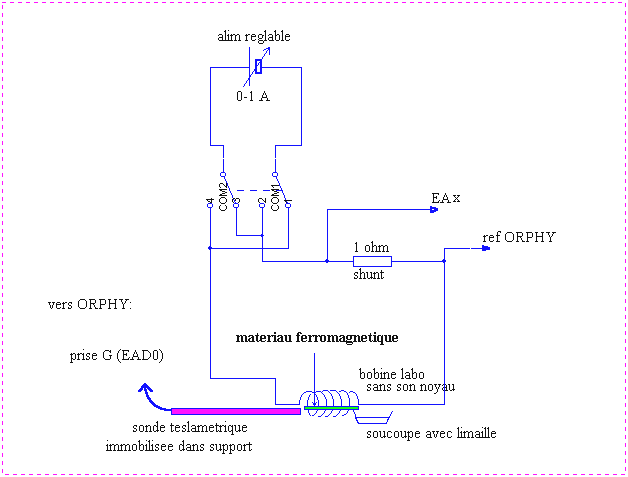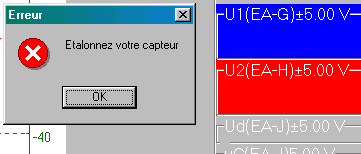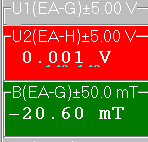FERRO(FERRI)MAGNÉTISME:
tracé et étude d'un CYCLE D'HYSTÉRÉSIS
![]()
I Objectifs
II Montage et réglages pour l'acquisition
III Mesures
IV Étude du cycle d'hystérésis du matériau
V Comparaison de différents matériaux dans des
pages d'acquisitions successives
![]()
|
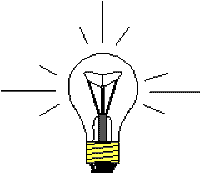 |
Remarque: le principe de ce T.P. est dû en particulier à l'aimable collaboration de Guy Lefèvre du groupe Évariste, que je remercie.
II Montage et réglages pour l'acquisition
A. Principe
Le matériau magnétique est placé à l'intérieur d'une bobine. Le courant d'excitation dans la bobine est réglé manuellement de façon à faire décrire au matériau son cycle d'hystérésis en même temps que se fait l'acquisition du courant d'excitation et du champ magnétique dans le matériau. B. Circuit électriqueIl doit comporter:
| une grosse bobine de type 'Labo' | |
| un générateur de courant 0-1 A (suffisant dans la plupart des cas pour observer le début de la saturation); sinon, pour une bobine de résistance 10 ohms, prévoir une source de tension 0-10 V et un rhéostat de réglage de 200 ohms environ | |
| un dispositif de mesure ou d'acquisition automatique de l'intensité excitatrice avec son signe algébrique: soit un ampèremètre, soit, mieux, un shunt (=résistor de précision) de 1 ohm placé en série avec la bobine (ATTENTION: Imax=1 A! Prévoir donc une puissance dissipable suffisante) | |
| le raccordement de la sonde teslamétrique à ORPHY. |
Il est 'confortable' de prévoir un commutateur avec inverseur entre le générateur et la bobine pour inverser le sens du courant en cours de cycle lorsque la valeur du champ magnétique rémanent est atteinte.
C. Matériau magnétique étudié Les grosses bobines de type 'Labo' comportent en général un noyau coulissant qu'il faut retirer pour le remplacer par le matériau magnétique. Ce matériau sera constitué tour à tour de différentes tiges droites en fer doux, acier dur, etc. choisies parmi les objets usuels de l'atelier du laboratoire: une tige filetée, un chasse-goupille, une lame de scie à métaux, une lime, une broche de maçon ou un burin, etc. Pour le ferrimagnétisme, le mieux est de prendre les tiges de ferrite utilisées pour l'enseignement de la Spécialité sciences physiques en classe de Terminale S.| Cette tige doit être immobilisée dans un support, ou bien placée de façon symétrique par rapport au centre de la bobine afin qu'elle ne soit pas "avalée" par la bobine lorsque l'excitation magnétique croît. | |
| Pour le tracé d'une courbe de 1 ère aimantation, il faut désaimanter préalablement le matériau en le plaçant quelques instants à l'intérieur d'une bobine alimentée par une tension alternative dont on fait décroître l'amplitude jusqu'à zéro. | |
| La sonde teslamétrique, immobilisée dans un support, est placée de façon que son petit capteur touche une extrémité de la tige(1) de fer ou de l'acier à étudier | |
| Sous l'autre extrémité de la tige (à environ 1 cm), il peut être judicieux de disposer de la limaille de fer pour voir celle-ci rester soulevée sous l'action du champ rémanent lorsqu'on annule l'excitation, puis retomber lorsqu'on atteint l'excitation coercitive, au cours du tracé du cycle d'hystérésis. |
D. Le capteur teslamétrique: nouveau capteur M12P302 pour prise DB15
(NB: pour l'ancien capteur à prise DIN 6 broches, voir paragraphe suivant)
|
Penser à brancher les
haut-parleurs! |
|
SONDE TESLAMÉTRIQUE (réf M10416) |
 |
Les capteurs de cette nouvelle série pour prises DB15 (prises G, H, etc.) sont des capteurs à reconnaissance automatique: BRANCHEZ ET CA MARCHE!
|
Dès que le capteur est branché, le logiciel d'acquisition actualise l'affichage des voies actives pour le faire apparaître.
|
(1) BRANCHER:
|
|
(2) ETALONNER: CLIQUER sur la zone d'affichage du capteur pour accéder au bouton d'étalonnage:
|
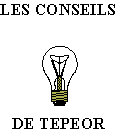 |
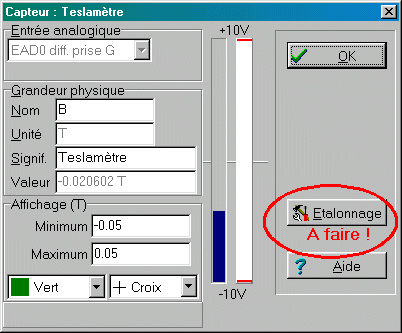 |
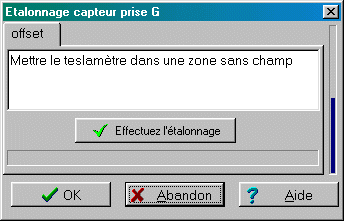
L'étalonnage s'effectue alors automatiquement: la tension de décalage (="offset") est corrigée de façon logicielle jusqu'à l'obtention du zéro.
|
NB: L'étalonnage n'est pas mémorisé par le système: il doit être repris à chaque branchement du capteur et/ou à chaque nouvelle session du logiciel d'acquisition.
E. Le capteur teslamétrique: ancien capteur M10416 avec prise din 6 broches
(pour le nouveau capteur à prise DB 15 broches, voir paragraphe précédent)
1. Présentation et mise en oeuvre
 |
ancien modèle SONDE TESLAMÉTRIQUE |
N.B.: avec GTI2 ou GTS2, l'adaptateur teslamétrique (pour prises G ou H) est indispensable |
 |
|
|
| Ce réglage de zéro demande à être repris plusieurs fois en cours de mesures (par exemple toutes les 10 mesures). | |
| Le sens choisi pour placer la sonde conditionne le signe avec lequel est mesuré B. |
2. Visionner le branchement du teslamètre et le réglage du zéro
|
Penser à brancher
les haut-parleurs! |
F. Réglages logiciels
Abscisse: |
Voies actives: |
Enregistrement: |
Acquisition: |
||||
EA x ouclavier: I (A) |
EA: |
Variable: |
Signe: |
Cal: |
Unité: |
Par point |
|
EADx (**) |
B |
± |
50 |
mT |
|||
* avec ORPHY-PORTABLE 2: brancher capsule Teslamètre.
(**) avec ORPHY-GTI2 ou GTS2, choisir EAD0 sur la prise G et calibre ±50 mT.
Deux cas sont à envisager pour la configuration de l'abscisse:
1.Cas de la saisie au clavier de l'intensité
Lors de la configuration de l'abscisse clavier, il faut indiquer au logiciel les extrema des valeurs de l'intensité qui seront utilisées au cours du cycle; cela demande donc un essai préalable pour déterminer l'intensité nécessaire à la saturation du matériau magnétique.
2.Cas de l'acquisition automatique par shunt
Le résistor s (shunt d'acquisition) est destiné à permettre indirectement l'acquisition de l'intensité i dans le circuit série par l'intermédiaire de la tension entre ses bornes; prévoir une résistance de précision de 1 ohm (ATTENTION à sa puissance dissipable: Imax=1 A!), ce qui est largement suffisant pour obtenir une tension de 1 V, et rendra très simple l'étalonnage direct en intensité.
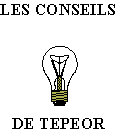 |
Une solution peut être, en effet, de déclarer sur EAx un capteur d'intensité (le shunt s) et de rentrer lors de son étalonnage manuel la correspondance: |
|
| tension sur EAx (us en V): | grandeur mesurée (I en mA): |
|
| 0 | 0 |
|
| 1 | 1/s= 1 mA | |
Sinon, la variable intensité sera créée à partir de la variable UEA après le transfert vers Regressi. |
||
Débuter l'acquisition pré réglée:
| (I au clavier): | * avec PORTABLE 2 ou USB | * avec GTI2 | * avec GTS2 |
| (I auto par shunt R): | * avec PORTABLE 2 ou USB | * avec GTI2 | * avec GTS2 |
III Mesures
A. Préliminaires| Brancher la sonde teslamétrique sur Orphy et mettre l'interface sous tension une dizaine de minutes avant le début des mesures de façon que les circuits intégrés du capteur se soient stabilisés en température, ce qui diminue le risque de dérive du réglage de zéro suivant | |
| Réaliser le zéro de la sonde teslamétrique en l'absence de champ magnétique (I = 0). Sans faire d'acquisition, la vérification est très facile à faire en observant la position verticale du curseur sur l'écran d'acquisition: amener cette position sur la valeur 0 en réglant le bouton de décalage (petite vis située à la base du bras porte sonde) | |
| Ce réglage de zéro ne pourra pas être repris en cours de mesures soit parce que l'annulation du courant aurait pour effet d'interrompre le tracé du cycle en cours, soit à cause du champ magnétique rémanent lorsque I = 0. |
|
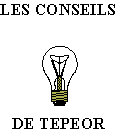 |
| Commencer avec I = 0; observer s'il existe un champ rémanent et tracer point par point la courbe de première (ou deuxième aimantation), en faisant croître l'intensité par petits pas sans jamais revenir en arrière, à cause de l'hystérésis. Chaque validation enregistre la nouvelle valeur de B en même temps que celle de l'intensité. | |
| Augmenter I jusqu'à 1 A, puis la diminuer jusqu'à 0: observer alors (sauf pour le fer doux) le champ rémanent en même temps que la limaille reste collée à la tige. | |
| Inverser le sens du courant et recommencer de même, en notant bien que la limaille ne retombe que lorsque I atteint la valeur dite coercitive. | |
| Poursuivre comme précédemment jusqu'à (-Imax) puis 0 à nouveau; noter encore l'hystérésis éventuel en l'absence de courant. | |
| Inverser à nouveau le sens du courant (qui se retrouve donc dans le sens primitif) pour terminer le cycle complet. | |
| Transférer l'ensemble de l'acquisition vers Regressi. |
Si une intensité maximale de 1 A s'avère insuffisante pour saturer franchement le matériau, augmenter Imax et utiliser un calibre de mesure plus grand (EA0 à EA3 avec GTS).
C. Variables transféréesÄ num, I et B.
Dans la fenêtre 'Graphiques' (menu Fenêtre/graphe Variables),
cliquer-D pour choisir 'Coordonnées' dans le menu contextuel, ou cliquer-G sur l'icône
correspondante ![]() et choisir ou vérifier qu'on a bien :
et choisir ou vérifier qu'on a bien :
| I (ou UEAx suivant le choix fait de variable d'acquisition) en abscisses | |
| B en ordonnées (à gauche) |
On a ainsi la représentation graphique de B = f(I).
Ä Il faut penser à indiquer sous forme de commentaire dans la boîte de dialogue du transfert le type de matériau utilisé dans chaque page d'acquisition pour pouvoir différencier ultérieurement tous ceux qui ont été utilisés.
IV Étude du cycle d'hystérésis du matériau
A. Visualisation
Dans la fenêtre 'Grandeurs':| Créer la nouvelle grandeur I, si celle-ci n'a pas fait l'objet d'un étalonnage direct lors de l'acquisition; saisir directement dans une nouvelle ligne du 'mémo' de l'onglet 'Expressions': |
I = UEA
I = UEAx / 1_A
en respectant exactement la syntaxe du trait de soulignement _A, destinée à créer simultanément l'unité de I (l'unité correspondante n'a pu être trouvée par le programme puisque celui-ci ignore a priori la dimension de s). Valider(2) par la touche 'F2' ou en cliquant-G sur l'icône clignotante
; le résultat apparaît alors dans une nouvelle colonne de l'onglet 'Variables'; vérifier dans l'onglet 'Unités' la présence de la nouvelle unité.
| Le nom d'une variable peut être modifié ultérieurement à sa création par double-clic sur la tête de colonne correspondante dans l'onglet 'Variables': il suffit alors de renseigner la boîte de dialogue qui s'ouvre. |
B. Grandeurs caractéristiques du cycle
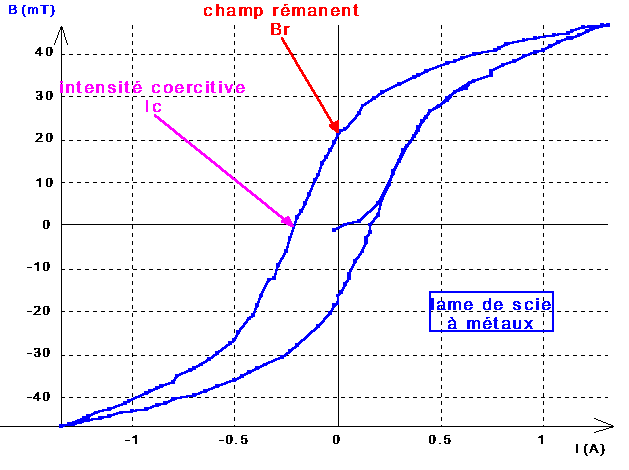
(si on a créé I à partir de UEAx) Dans la fenêtre
'Graphiques' (menu Fenêtre/graphe Variables), clic-D pour choisir 'Coordonnées' dans le
menu contextuel, ou clic-G sur l'icône correspondante
|
Observer le graphique B = f(I) qui doit se présenter
sous forme de cycle. Si ce n'était pas le cas, il faudrait demander au logiciel de trier
les valeurs en fonction du paramètre d'acquisition num: menu 'Pages / Trier', ou
bien dans la fenêtre 'Grandeurs' cliquer-D dans l'onglet 'Grandeurs' pour choisir 'Trier
variables' dans le menu contextuel ou cliquer-G sur l'icône ![]() :
choisir alors le paramètre num dans la boîte de dialogue qui s'ouvre.
:
choisir alors le paramètre num dans la boîte de dialogue qui s'ouvre.
Remarquer les valeurs particulières des points d'intersection avec les axes: ± Br, et ± Ic.
| On peut annoter le graphique par des commentaires au moyen du curseur 'Texte': choisir ce curseur et effectuer un cliquer tirer du pointeur. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, saisir un texte dans l'onglet 'Texte', puis choisir dans l'onglet 'Options' la flèche et la ligne de rappel: après validation, le texte et la flèche apparaissent; un cliquer-glisser sur ces objets permet de les déplacer, et un double clic-G permet de les éditer (=modifier une de leurs caractéristiques) | |
| Le titre se place en sélectionnant le curseur 'Texte' puis en cliquant-G
à l'endroit souhaité du graphique (le choix du paramètre %S dans l'onglet 'Texte' de la
boîte de dialogue associée insère automatiquement le commentaire de page tel qu'il
figure dans la partie droite de la barre d'icônes principale de Regressi). On peut
ménager un peu d'espace entre le haut de la courbe et celui du graphique en imposant un
maximum plus grand pour l'axe B avec l'icône |
| Les pertes par hystérésis dans un matériau
magnétique sont proportionnelles à l'aire S de son cycle d'hystérésis; elles
sont données en watts par la relation:
p = k*f*S où f représente la fréquence de variation de l'excitation magnétique. La mesure de cette aire S constitue donc une donnée physique importante. |
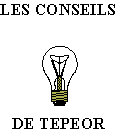 |
Revenir dans la fenêtre 'Grandeurs', onglet 'Expressions', et y saisir directement dans une nouvelle ligne:
aire = INTG(B, I).
(NB: On peut aussi utiliser la fonction aire(B,I) qui donne la valeur de la surface définie par I et B.)
La grandeur correspondante apparaît dans une nouvelle
colonne de l'onglet 'Variables', où chaque ligne représente la valeur de l'intégrale
avec un terme supplémentaire dans la sommation; c'est donc seulement le dernière
ligne de ces valeurs qui donne la valeur de l'intégrale sur le cycle entier. Vérifier
aussi dans l'onglet 'Unités' que l'unité
correspondante(3) a bien été trouvée par le programme; sinon, la forcer en cliquant
sur l'icône ![]() , ou saisir celle-ci manuellement.
, ou saisir celle-ci manuellement.
V Comparaison de différents matériaux dans des pages d'acquisitions successives
A. Acquisitions et transferts
Il faut réaliser plusieurs acquisitions en changeant la nature du
matériau magnétique placé dans la bobine.
Le logiciel d'acquisition étant ouvert, il faut lui 're donner la main' en cliquant sur
l'icône ![]() de Regressi (sert de bascule vers le programme
d'acquisition). Sinon, choisir 'Fichier /Nouveau /Nom d'interface' dans le menu de
Regressi. Dans les dernières versions de Regressi, il suffit d'ailleurs de demander 'Page
/Nouvelle' à partir d'une page déjà transférée. Après chaque nouvelle acquisition,
il faut évidemment choisir 'Nouvelle page' dans la boîte de dialogue sur le transfert,
pour pouvoir comparer dans Regressi les différentes pages d'acquisition à l'intérieur
d'un même fichier(4). Il faut également
penser à indiquer sous forme de commentaire la nature du matériau courant dans la boîte
de dialogue de transfert; sinon, il n'y aura qu' à le saisir a posteriori dans la
ligne de saisie située à droite de la barre principale d'icônes de la fenêtre
logicielle de Regressi. Lors de chaque importation de nouvelle page d'acquisition dans
Regressi, la grandeur représentant l'aire du cycle d'hystérésis est calculée
automatiquement. Il n'y a plus qu'à comparer sa valeur entre les différentes pages.
de Regressi (sert de bascule vers le programme
d'acquisition). Sinon, choisir 'Fichier /Nouveau /Nom d'interface' dans le menu de
Regressi. Dans les dernières versions de Regressi, il suffit d'ailleurs de demander 'Page
/Nouvelle' à partir d'une page déjà transférée. Après chaque nouvelle acquisition,
il faut évidemment choisir 'Nouvelle page' dans la boîte de dialogue sur le transfert,
pour pouvoir comparer dans Regressi les différentes pages d'acquisition à l'intérieur
d'un même fichier(4). Il faut également
penser à indiquer sous forme de commentaire la nature du matériau courant dans la boîte
de dialogue de transfert; sinon, il n'y aura qu' à le saisir a posteriori dans la
ligne de saisie située à droite de la barre principale d'icônes de la fenêtre
logicielle de Regressi. Lors de chaque importation de nouvelle page d'acquisition dans
Regressi, la grandeur représentant l'aire du cycle d'hystérésis est calculée
automatiquement. Il n'y a plus qu'à comparer sa valeur entre les différentes pages.
La navigation entre les pages s'effectue par clic-G sur les flèches 'Magnétoscope' ![]()
![]()
![]()
![]() situées
dans la barre principale d'icônes de la fenêtre logicielle (ou bien par les raccourcis
clavier F7 /F8).
situées
dans la barre principale d'icônes de la fenêtre logicielle (ou bien par les raccourcis
clavier F7 /F8).
B. Comparaison des cycles entre eux
La superposition des différents cycles obtenus facilite leur
comparaison. Il suffit de cocher 'Superposition de pages' dans une des boîtes de dialogue
'Coordonnées' ou 'Options' obtenues par clic-G sur les icônes respectives ![]() ou
ou ![]() , ou bien par clic-D dans la
fenêtre 'Graphique' (menu contextuel). L'icône
, ou bien par clic-D dans la
fenêtre 'Graphique' (menu contextuel). L'icône ![]() ,
accessible dans les boîtes précédentes ou dans la barre principale d'icônes de la
fenêtre programme, permet de sélectionner (en cochant la case correspondante) parmi
toutes les pages d'un même fichier celles à superposer.
,
accessible dans les boîtes précédentes ou dans la barre principale d'icônes de la
fenêtre programme, permet de sélectionner (en cochant la case correspondante) parmi
toutes les pages d'un même fichier celles à superposer.
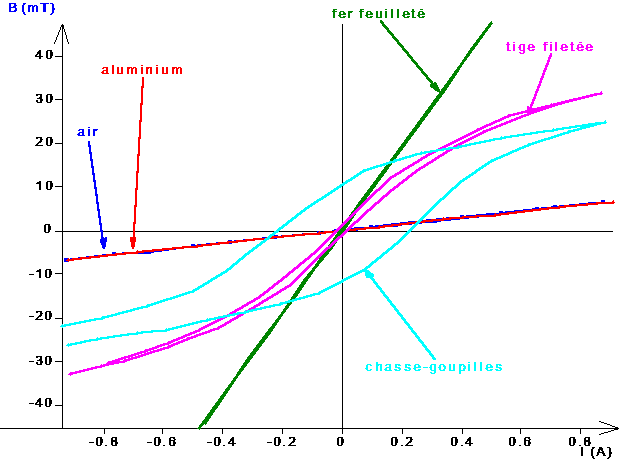
Un clic-G sur l'icône ![]() d'identification
des pages affiche automatiquement sur le graphique leur signification sous forme de
légende. La position de ces légendes et des flèches correspondantes peut être
modifiée par cliquer-glisser du pointeur quand il se transforme en 'main' au survol des
zones 'sensibles'.
d'identification
des pages affiche automatiquement sur le graphique leur signification sous forme de
légende. La position de ces légendes et des flèches correspondantes peut être
modifiée par cliquer-glisser du pointeur quand il se transforme en 'main' au survol des
zones 'sensibles'.
C. Comparaison des matériaux entre eux
| L'air et l'aluminium sont des matériaux linéaires, sans saturation possible, de perméabilité magnétique absolue beaucoup plus faible que les autres, dits ferro(ferri)magnétiques. | |||||
| Le fer feuilleté (qui constitue le noyau coulissant des inductances réglables) ne présente pas d'hystérésis visible, ni d'amorce de saturation à 1 A: il convient donc parfaitement pour ces bobine utilisées par ailleurs en courant alternatif et se comportera linéairement. | |||||
| La ferrite offre les mêmes avantages (donc pas de pertes par hystérésis en H.F. si on l'emploie dans les noyaux de bobines P.O./ G.O.). Comme c'est de plus un isolant électrique (tester un bâton de ferrite avec les cordons d'un ohmmètre), elle ignorera aussi les pertes par courants de Foucault lors du même usage en H.F.! En résumé, pas de 'pertes fer' dans ce composite. | |||||
L'acier dur qui constitue les outils possède à la fois:
|
![]()