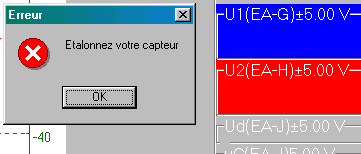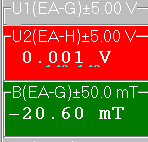THÉORÈME D'AMPÈRE:
vérification avec une ou deux bobines
![]()
II Principe de l'étude
III Montage et réglages pour l'acquisition
IV Mesures
V Calculs et exploitation
VI Nouvelles expériences avec des configurations matérielles différentes
![]()
|
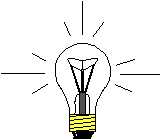 |
II Principe de l'étude
A. Rappel théorique
Il s'agit de vérifier que la somme algébrique des intensités entrelacées par un contour fermé (C) est égale à la circulation(1) du vecteur excitation magnétique![]()
où ![]() représente la f.m.m. (force ou faculté magnétomotrice) du circuit électrique. Il faut
pour cela calculer séparément chacun des deux membres de cette équation:
représente la f.m.m. (force ou faculté magnétomotrice) du circuit électrique. Il faut
pour cela calculer séparément chacun des deux membres de cette équation:
| Premier membre: si le milieu traversé par (C) est l'air, on a : B = µ0*H, d'où: |
![]()
où Bt représente la composante tangentielle de ![]()
| Deuxième membre: Un sens de parcours étant choisi sur le contour (celui de la ligne de champ le cas échéant), l'intensité enlacée est comptée positivement ou négativement suivant qu'elle traverse la surface intérieure du circuit dans le même sens ou non que le vecteur normal associé au contour orienté. |
![]()
sur un parcours marqué de cm en cm de N points numérotés de 0 à N. on remplace l'intégrale sur un continuum de valeurs de s par une somme discrète sur des valeurs de l'abscisse curviligne s (variable d'intégration) variant de cm en cm.
III Montage et réglages pour l'acquisition
A. Circuit électrique et montage
Il est constitué d'une ou deux bobines suivant la configuration retenue: le cas échéant, placer de préférence les deux bobines en série, en insérant un ampèremètre dans leur circuit de façon qu'il indique l'intensité commune aux 2 bobines. Une alimentation réglable, de préférence à un rhéostat (par économie d'énergie…), permet de régler cette intensité I par exemple à 2 A.
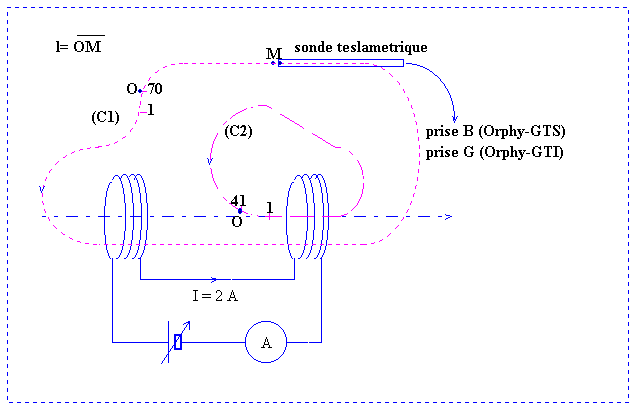
B. Contour pour le calcul de la circulation du vecteur 
Différentes formes et longueurs de contour sont
tracées sur une plaque horizontale servant de support pour la sonde de mesure et de plan
diamétral pour les différentes bobines. Chaque contour enlace ou non l'intensité des
spires de chaque bobine:
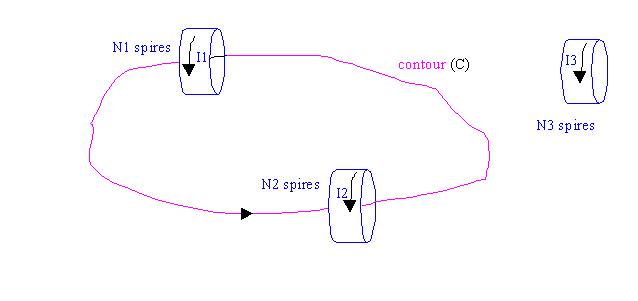
En fonction de ces différents éléments, le théorème d'Ampère s'écrira ici:
![]()
Ces contours doivent comporter par exemple entre 40 et 70 divisions centimétriques pour permettre une résolution suffisante sans toutefois trop alourdir le nombre de mesures à effectuer, de cm en cm. Chacune de ces divisions est numérotée, de 1 à N: ce n° de division, rapide à saisir lors de l'acquisition (variable d'acquisition nommée num par la suite), représente donc l'abscisse curviligne l de chaque point à étudier, exprimée en cm.
C. Le capteur teslamétrique: nouveau capteur M12P302 pour prise DB15
(NB: pour l'ancien capteur à prise DIN 6 broches, voir paragraphe suivant)
|
Penser à brancher les
haut-parleurs! |
|
SONDE TESLAMÉTRIQUE (réf M10416) |
 |
Les capteurs de cette nouvelle série pour prises DB15 (prises G, H, etc.) sont des capteurs à reconnaissance automatique: BRANCHEZ ET CA MARCHE!
|
Dès que le capteur est branché, le logiciel d'acquisition actualise l'affichage des voies actives pour le faire apparaître.
|
(1) BRANCHER:
|
|
(2) ETALONNER: CLIQUER sur la zone d'affichage du capteur pour accéder au bouton d'étalonnage:
|
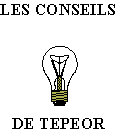 |
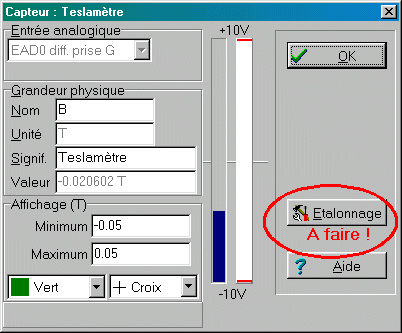 |
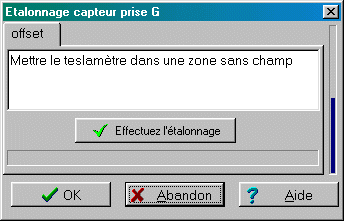
L'étalonnage s'effectue alors automatiquement: la tension de décalage (="offset") est corrigée de façon logicielle jusqu'à l'obtention du zéro.
|
NB: L'étalonnage n'est pas mémorisé par le système: il doit être repris à chaque branchement du capteur et/ou à chaque nouvelle session du logiciel d'acquisition.
D. Le capteur teslamétrique: ancien capteur M10416 avec prise din 6 broches
(pour le nouveau capteur à prise DB 15 broches, voir paragraphe précédent)
1. Présentation et mise en oeuvre
 |
ancien modèle SONDE TESLAMÉTRIQUE |
N.B.: avec GTI2 ou GTS2, l'adaptateur teslamétrique (pour prises G ou H) est indispensable |
 |
|
|
| Ce réglage de zéro demande à être repris plusieurs fois en cours de mesures (par exemple toutes les 10 mesures). | |
| Le sens choisi pour placer la sonde conditionne le signe avec lequel est mesuré B. |
2. Visionner le branchement du teslamètre et le réglage du zéro
|
Penser à brancher
les haut-parleurs! |
E. Réglages logiciels
| Abscisse: | Voies actives: |
Enregistrement: |
Acquisition: |
||||
(clavier) |
EAx: |
Variable: |
Signe: |
Cal: |
Unité: |
|
|
EA D(*) |
B |
± |
5 |
mT |
|||
(*) avec ORPHY-GTI2 ou GTS 2, choisir EAD0 sur la prise G et calibre ±5 mT.
* avec ORPHY-PORTABLE 2: brancher: capsule Teslamètre.
|
avec ORPHY PORTABLE 2, brancher: une capsule Teslamètre ±4 mT. |
Charger l'acquisition pré réglée:
| * avec ORPHY-GTS2 | * avec ORPHY-GTI2 |
IV. Mesures
A. Protocole d'acquisition
|
|
| Ce réglage de zéro demande à être repris plusieurs fois en cours de mesures (par exemple toutes les 10 mesures)Positionner le bras de façon que son axe soit bien tangent au contour choisi, le capteur étant placé sur la division n°1, saisir ce n° au clavier et valider, ce qui enregistre à la fois le n° (variable num) d'acquisition et la valeur courante (variable B) du champ magnétique | |
| Le sens choisi pour placer la sonde sur chaque nouvelle position de tangente doit être conservé par continuité sur tout le parcours et conditionnera le signe avec lequel est mesuré B; suivant le sens choisi, il se peut que l'on trouve l'intégrale avec le signe opposé de celui voulu. Pour l'éviter, il faut repérer quel sens de la sonde donne une mesure positive de Bt lorsque celle-ci est dans le sens de parcours choisi (0 à N) | |
| Passer à la division n°2 en procédant de même, et ainsi de suite jusqu'à la division N (qui correspond en fait à la division n° puisqu'on va achever un tour | |
| Transférer cette acquisition vers Regressi |
B. Variables transférées
Ä num, et B.
Dans la fenêtre 'Graphiques' (menu Fenêtre/graphe
Variables), cliquer-D pour choisir 'Coordonnées' dans le menu contextuel, ou cliquer-G
sur l'icône correspondante
|
On a ainsi la représentation graphique de B = f(num); mais celle-ci ne présente pas beaucoup d'intérêt en soi, le but étant le calcul de l'intégrale curviligne. |
Ä Il est préférable de demander aussi lors du transfert celui des paramètres N1, N2, I1, et I2 après les avoir indiqués dans la boîte de dialogue du transfert (si celle-ci offre cette possibilité), avec leurs valeurs dans chaque page d'acquisition. en prévision du calcul ultérieur, il faut indiquer 0 pour la valeur de l'intensité si celle-ci n'est pas enlacée par le contour.
V Calculs et exploitation
A. Calcul des nouvelles variables H et l
Revenir dans la fenêtre 'Grandeurs':| Pour créer la nouvelle grandeur H, saisir directement dans une nouvelle ligne du 'mémo' de l'onglet 'Expressions': |
H=B/(4*p *10^(-7))_A.tr/m
en respectant exactement la syntaxe du trait de soulignement _ et de sa suite, destinés à créer simultanément l'unité de H (l'unité correspondante n'a pu être trouvée par le programme puisque celui-ci ignore a priori la dimension de µo). Valider(2) par la touche 'F2' ou en cliquant-G sur l'icône clignotante
; le résultat apparaît dans une nouvelle colonne de l'onglet 'Variables'; vérifier dans l'onglet 'Unités' la présence de la nouvelle unité
| Passer à la ligne (touche 'Entrée') dans l'onglet 'Expressions' pour saisir encore: |
l=num*10^(-2)_m
(l'unité doit aussi être indiquée au programme qui ignore a priori la dimension de l) et vérifier de même sa prise en compte, ainsi que celle de l'unité
| Le nom d'une variable, par exemple celle d'abscisse curviligne (l ici) peut être modifié ultérieurement à sa création par double-clic sur la tête de colonne correspondante dans l'onglet 'Variables': il suffit alors de renseigner la boîte de dialogue qui s'ouvre. |
B. Visualisation de 
Dans la fenêtre 'Graphiques' (menu Fenêtre/graphe Variables), clic-D
pour choisir 'Coordonnées' dans le menu contextuel, ou clic-G sur l'icône
correspondante
|
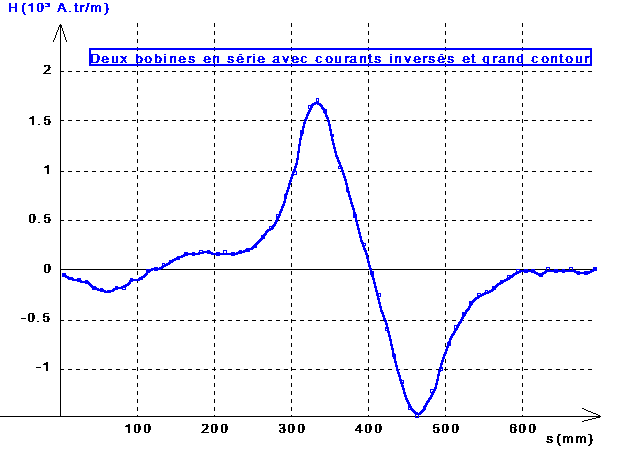
Observer le graphique H = f(l) , analogue évidemment à celui de B = f(num) , et dont l'interprétation n'a guère d'intérêt ici. | |
Le titre se place en sélectionnant le curseur 'Texte' puis en
cliquant-G à l'endroit souhaité du graphique (le choix du paramètre %s dans l'onglet
'Texte' de la boîte de dialogue associée insère automatiquement le commentaire de page
tel qu'il figure dans la partie droite de la barre d'icônes principale de Regressi). On
peut ménager un peu d'espace entre le haut de la courbe et celui du graphique en imposant
un maximum plus grand pour l'axe H avec l'icône |
C. Calcul de l'intégrale curviligne
Revenir dans la fenêtre 'Grandeurs', onglet 'Expressions', et y saisir directement dans une nouvelle ligne:
somme = INTG(H,l).
La grandeur correspondante apparaît dans une nouvelle colonne de
l'onglet 'Variables', où chaque ligne représente la valeur de l'intégrale avec un terme
supplémentaire dans la somation; c'est donc seulement le dernière ligne de ces valeurs
qui donne la valeur de l'intégrale sur le contour fermé. Vérifier aussi dans l'onglet
'Unités' que l'unité correspondante(3) a bien
été trouvée par le programme; sinon, la forcer en cliquant sur l'icône ![]() , ou saisir celle-ci manuellement.
, ou saisir celle-ci manuellement.
Pour faire apparaître la représentation de la nouvelle grandeur sur le graphique, demander somme en 2 ème ordonnée (à droite, car échelle différente de l'autre ordonnée H) dans la fenêtre graphique.
D. Vérification du théorème d'Ampère
La valeur du 2 ème membre du théorème d'Ampère peut aussi être calculée directement par voie logicielle. Il faut pour cela disposer dans l'onglet 'Paramètres' de la fenêtre 'Grandeurs' des valeurs de N1, N2, I1, et I2 qui s'y trouvent si elles ont été transférées avec l'acquisition. Sinon, ces paramètres peuvent être créés a posteriori:
1. création des paramètres expérimentaux
N1 = 98_tr
|
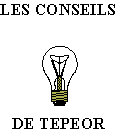 |
| Paramètres de page: ce sont les intensités I1
et I2 qui peuvent changer de valeur ou de signe avec chaque configuration du
montage d'acquisition. Cliquer-G sur l'icône |
NB: si des intensités ne sont pas entrelacées par le contour, il faut saisir la valeur 0 pour celles-ci!
Contrôler les unités de ces nouvelles grandeurs comme dans les créations précédentes de variables.
2. calcul du terme 
Saisir dans une nouvelle ligne de l'onglet 'Expressions':
S NI=N1*I1+N2*I2 ou bien: sommebis=N1*I1+N2*I2
et le terme représentant cette somme est aussitôt créé dans l'onglet 'paramètres' où on peut lire sa valeur. Contrôler l'unité comme précédemment pour le calcul de l'intégrale.
3. vérification du théorème et synthèse graphique
Il ne reste plus qu'à la comparer à celle obtenue pour l'intégrale curviligne pour pouvoir valider le théorème d'Ampère. le degré de concordance dépend dans une large mesure du soin avec lequel la sonde teslamétrique a été positionnée pour chacune des mesures. Il est possible d'obtenir une concordance à 3 ou 4% près. On peut superposer sur le graphique obtenu au paragraphe (III C) la valeur correspondant à SNI. Mais comme Regressi ne reconnaît que des variables dans ses coordonnées graphiques, il faut d'abord créer une variable (qui sera constante ici!) égale à S NI; saisir pour cela dans l'onglet 'Expressions':y = S (NI)+ 0*l
avec le terme 0*l qui est indispensable pour que
Regressi reconnaisse y comme une variable. Revenir alors à la fenêtre graphique
pour y choisir y comme 3 ème ordonnée à droite (puisque même échelle que
l'intégrale somme).
La vérification du théorème d'Ampère se fait alors directement sur le graphe en
comparant l'ordonnée de la droite y= Cte avec le dernier point à droite de somme,
cela dans chaque page du fichier. Un clic-G sur l'icône ![]() d'identification des courbes(5) affiche
automatiquement leur signification en légende sur le graphique.
d'identification des courbes(5) affiche
automatiquement leur signification en légende sur le graphique.
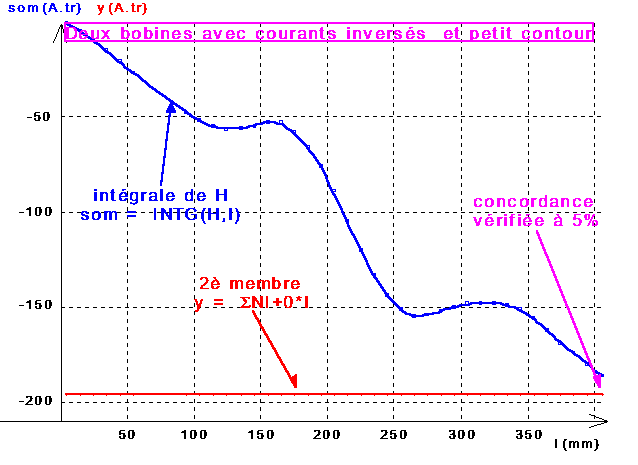
Pour détacher la droite y = Cte de l'axe l, il suffit de choisir une échelle manuelle pour som et y avec un minimum un peu plus bas. L'annotation du point de concordance s'obtient avec le curseur 'texte'.
VI. Nouvelles expériences avec des configurations matérielles différentes
Il s'agit de faire plusieurs acquisitions entre
lesquelles seule change la configuration du montage (intensités ou contours différent),
afin de valider dans des conditions variées le théorème d'Ampère.
Le logiciel d'acquisition étant ouvert, il faut lui 're donner la main' en cliquant sur
l'icône ![]() de Regressi (sert de bascule vers le programme
d'acquisition). Sinon, choisir 'Fichier /Nouveau /Nom d'interface' dans le menu de
Regressi. Dans les dernières versions de Regressi, il suffit d'ailleurs de demander 'Page
/Nouvelle' à partir d'une page déjà transférée. Après chaque nouvelle acquisition,
il faut évidemment choisir 'Nouvelle page' dans la boîte de dialogue sur le transfert,
pour pouvoir comparer dans Regressi les différentes pages d'acquisition à l'intérieur
d'un même fichier(6). Il faut également penser
à indiquer la valeur des paramètres courants dans la boîte de dialogue de transfert;
sinon, il n'y aura qu' à les saisir a posteriori dans l'onglet 'Paramètres' de la
fenêtre 'Grandeurs' de Regressi. Lors de chaque importation de nouvelle page
d'acquisition dans Regressi, les grandeurs représentant les deux membres du théorème
d'Ampère sont calculées automatiquement. Il n'y a plus qu'à les comparer.
de Regressi (sert de bascule vers le programme
d'acquisition). Sinon, choisir 'Fichier /Nouveau /Nom d'interface' dans le menu de
Regressi. Dans les dernières versions de Regressi, il suffit d'ailleurs de demander 'Page
/Nouvelle' à partir d'une page déjà transférée. Après chaque nouvelle acquisition,
il faut évidemment choisir 'Nouvelle page' dans la boîte de dialogue sur le transfert,
pour pouvoir comparer dans Regressi les différentes pages d'acquisition à l'intérieur
d'un même fichier(6). Il faut également penser
à indiquer la valeur des paramètres courants dans la boîte de dialogue de transfert;
sinon, il n'y aura qu' à les saisir a posteriori dans l'onglet 'Paramètres' de la
fenêtre 'Grandeurs' de Regressi. Lors de chaque importation de nouvelle page
d'acquisition dans Regressi, les grandeurs représentant les deux membres du théorème
d'Ampère sont calculées automatiquement. Il n'y a plus qu'à les comparer.
La navigation entre les pages s'effectue par clic-G sur les flèches 'Magnétoscope' ![]()
![]()
![]()
![]() situées
dans la barre principale d'icônes de la fenêtre logicielle (ou bien par les raccourcis
clavier F7 /F8).
situées
dans la barre principale d'icônes de la fenêtre logicielle (ou bien par les raccourcis
clavier F7 /F8).
![]()