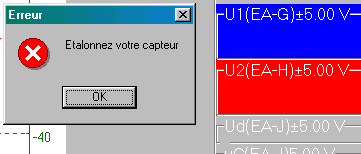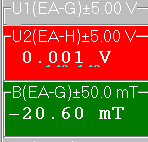CHAMP MAGNÉTIQUE créé par une BOBINE parcourue par un COURANT
![]()
II Principe de l'étude
III Montage et réglages pour l'acquisition
IV Influence de la longueur de la bobine: notion de solénoïde infiniment long
V Topographie du champ magnétique dans le solénoïde
VI Recherche de la relation entre le champ, l'intensité, et le nombre de spires
VII Étude similaire avec d'autres types de bobines
![]()
I Objectifs
N.B.: L'étude proposée ici se rapporte à un solénoïde. Elle pourra aisément être transposée à d'autres géométries de bobines. On se contentera d'étudier le champ sur l'axe de la bobine. |
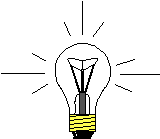 |
II Principe de l'étude
Le champ magnétique ![]() en un point à l'intérieur d'un solénoïde dépend de plusieurs paramètres:
en un point à l'intérieur d'un solénoïde dépend de plusieurs paramètres:
| la longueur l de la bobine | |
| la position du point, définie par rapport au centre (abscisse x comptée à partir du centre O de la bobine) | |
| le nombre de spires par mètre n (= N/l ) | |
| l'intensité du courant alimentant la bobine. |
F Pour étudier précisément l'effet de chacun de ces paramètres (l, x, n et I), il s'agit donc d'en faire varier un seul à la fois, en s'assurant de la constance des autres.
III Montage et réglages pour l'acquisition
A. Montage d'ensemble
Le shunt de précision de 1 W est utile seulement dans la
dernière partie, pour acquérir l'intensité directement.
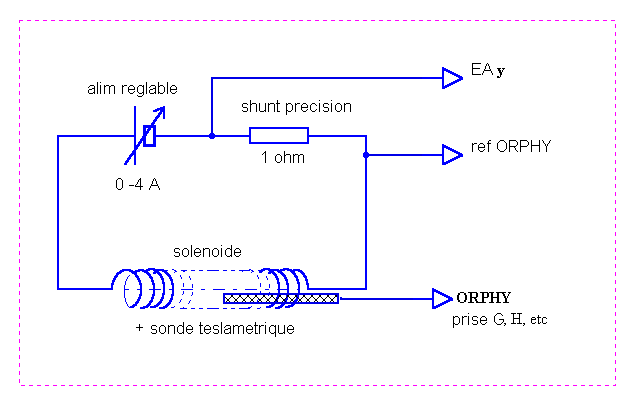
B. Réglages logiciels
| Abscisse: | Voies actives: |
Enregistrement: |
Acquisition: |
||||
clavier |
EAx: |
Variable: |
Signe: |
Cal: |
Unité: |
|
|
EAD |
B |
± |
5 |
mT |
|||
I |
EAy |
I |
+ |
5 |
A |
||
(NB: dernière ligne du tableau uniquement pour dernier paragraphe: acquisition automatique de l'intensité I)
* avec ORPHY-PORTABLE 2: brancher: capsule Teslamètre.
E. Le capteur teslamétrique: nouveau capteur M12P302 pour prise DB15, et étalonnage (réglage offset)
(NB: pour l'ancien capteur à prise DIN 6 broches, voir paragraphe suivant)
|
Penser à brancher les
haut-parleurs! |
|
SONDE TESLAMÉTRIQUE (réf M10416) |
 |
Les capteurs de cette nouvelle série pour prises DB15 (prises G, H, etc.) sont des capteurs à reconnaissance automatique: BRANCHEZ ET CA MARCHE!
|
Dès que le capteur est branché, le logiciel d'acquisition actualise l'affichage des voies actives pour le faire apparaître.
|
(1) BRANCHER:
|
|
(2) ETALONNER: CLIQUER sur la zone d'affichage du capteur pour accéder au bouton d'étalonnage:
|
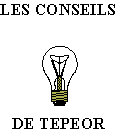 |
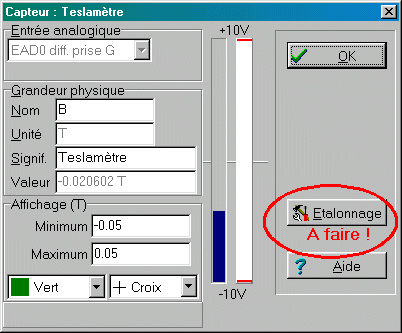 |
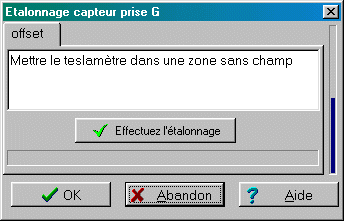
L'étalonnage s'effectue alors automatiquement: la tension de décalage (="offset") est corrigée de façon logicielle jusqu'à l'obtention du zéro.
|
NB: L'étalonnage n'est pas mémorisé par le système: il doit être repris à chaque branchement du capteur et/ou à chaque nouvelle session du logiciel d'acquisition.
F. Le capteur teslamétrique: ancien capteur M10416 avec prise din 6 broches
(pour le nouveau capteur à prise DB 15 broches, voir paragraphe précédent)
1. Présentation et mise en oeuvre
 |
ancien modèle SONDE TESLAMÉTRIQUE |
N.B.: avec GTI2 ou GTS2, l'adaptateur teslamétrique (pour prises G ou H) est indispensable |
 |
|
|
| Ce réglage de zéro demande à être repris plusieurs fois en cours de mesures (par exemple toutes les 10 mesures). | |
| Le sens choisi pour placer la sonde conditionne le signe avec lequel est mesuré B. |
2. Visionner le branchement du teslamètre et le réglage du zéro
|
Penser à brancher
les haut-parleurs! |
IV Influence de la longueur de la bobine: notion de solénoïde infiniment long
F On veut montrer ici qu'au-delà d'une certaine longueur l de bobine, le champ au centre de celle-ci ne dépend plus de la longueur: on définit ainsi le solénoïde infiniment long, et son modèle approché.
Pour les autres paramètres (x, n, I):
| la sonde placée au centre de la bobine assure x=0 en | |
| un rhéostat de réglage permet de maintenir constante intensité I dans la bobine lorsque sa longueur est modifiée | |
| le système de bobines imbriquées utilisé (avec des prises intermédiaires), avec un nombre de spires proportionnel à leur longueur garde n constant. |
A. Acquisition de B et l
Un rhéostat de réglage permet de conserver rigoureusement la même intensité I dans la bobine lorsque sa longueur est modifiée. La sonde teslamétrique doit toujours rester au centre de la bobine (x = 0). La longueur l de la bobine est évidemment rentrée au clavier.
Charger l'acquisition pré réglée:
| * avec ORPHY-GTS2 | * avec ORPHY-GTI2 |
Saisir la valeur de la longueur choisie: sa validation provoque simultanément l'acquisition de l et de la valeur correspondante de B.
B. Variables transférées
B et lDans la fenêtre 'Graphiques' (menu Fenêtre/graphe Variables), clic-D
pour choisir 'Coordonnées' dans le menu contextuel, ou clic-G sur l'icône correspondante
![]() ; choisir:
; choisir:
| l en abscisses |
| B en ordonnées (à gauche) |
On a ainsi la représentation graphique de B=f(l).
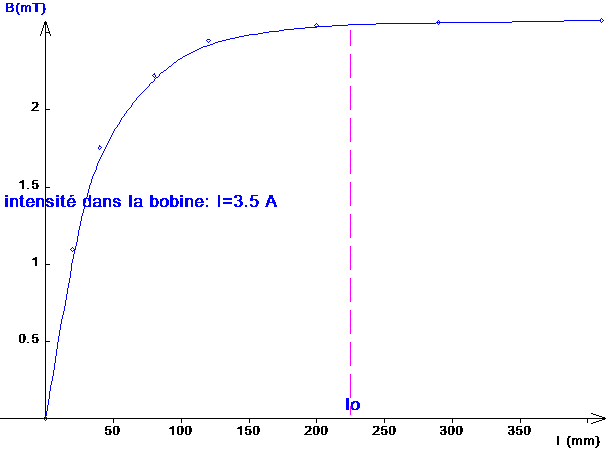
C. Exploitation: modèle du solénoïde infiniment long
Observer sur la courbe précédente qu'au delà d'une certaine longueur l0
(environ 10 fois le rayon du solénoïde), le champ au centre n'augmente pratiquement plus et a donc la même valeur que pour une bobine infiniment longue. On prendra dans toute la suite de cette étude une longueur l > l0 : elle permettra de rendre compte des propriétés du solénoïde infiniment long.V Topographie du champ magnétique dans le solénoïde: B=f(x)
F On s'attache donc ici à étudier l'influence de la position du point étudié (x).
Pour les autres paramètres (l, n, I):
| on utilise désormais la bobine de plus grande longueur (l max) | |
| le nombre de spires par unité de longueur reste le même (n=485 spires/m) | |
| l'intensité reste toujours la même (I=3.5 A). |
A. Acquisition de B et x
Soit x la distance du point étudié (position du capteur teslamétrique) au centre du solénoïde. Traiter en particulier le cas x > l/2 pour pouvoir étudier comment le champ décroît à l'extérieur de la bobine.
Charger l'acquisition pré réglée:
| * avec ORPHY-GTS2 | * avec ORPHY-GTI2 |
B. Variables transférées
| Si l'étude précédente vient d'être réalisée, bien demander le transfert dans un nouveau fichier, et non pas dans une nouvelle page du fichier précédent puisque sa structure n'est pas exactement la même (dénomination des variables). Les variables transférées sont: |
Dans la fenêtre 'Graphiques' (menu Fenêtre/graphe
Variables), clic-D pour choisir 'Coordonnées' dans le menu contextuel, ou clic-G sur
l'icône correspondante
|
On a ainsi la représentation graphique de B=f(x).
C. Exploitation: notion de champ uniforme
L'extrémité de la bobine correspond à l'abscisse de la dernière spire, soit x= l/2.
| Constater que à l'intérieur de la bobine, tant qu'on n'est pas trop près d'une extrémité, le champ est uniforme. Par conséquent, pour la suite de l'étude, le point où on place le capteur pourra se situer indifféremment n'importe où dans la zone centrale de champ uniforme: |
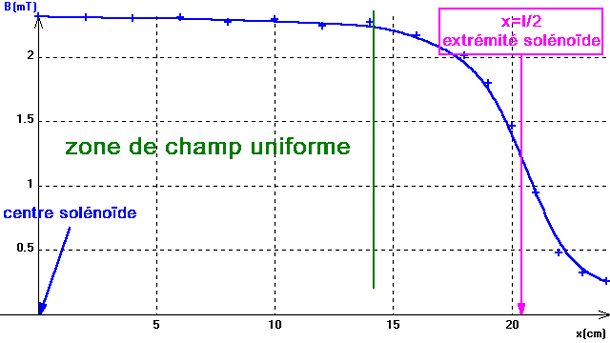
| A l'extérieur, observer que le champ sur l'axe décroît très rapidement. On peut aussi vérifier en plaçant la sonde hors de l'axe cette fois, tout près du bobinage, mais à l'extérieur, que le champ y est nul. |
VI
Recherche de la relation entre le champ, l'intensité, et le nombre de spires:
B=f(I,n)
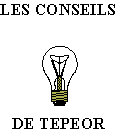 |
On introduit le nombre de spires par mètre, n, qui est ici le véritable paramètre physique. Le type de solénoïde utilisé doit permettre de faire varier n sans modifier la longueur de la bobine. On va montrer la proportionnalité de B à la fois à n et à I, pour en déduire finalement la perméabilité magnétique µ0 de l'air (du vide). |
A. Étude de B = f(I) avec un enroulement simple (n = n1)
F On cherche d'abord à étudier l'influence de l'intensité seule.
Pour les autres paramètres (l, n, x):
| on utilise désormais la bobine de plus grande longueur (l ) | |
| le nombre de spires reste le même (n) | |
| la sonde est maintenue au centre (x=0). |
1. acquisition et transfert
Débuter l'acquisition pré réglée:
| (I au clavier) | * avec portable 2 ou USB | * avec GTI2 | * avec GTS2 |
| (I auto par shunt) | * avec portable 2 ou USB | * avec GTI2 | * avec GTS2 |
| Montage: placer un ampèremètre en série pour pouvoir saisir au clavier la valeur lue pour l'intensité, ou utiliser le shunt (1 ohm) d'acquisition directe de la tension proportionnelle par ORPHY | |
| Acquisition: penser au point correspondant à une intensité nulle! |
| Variables transférées: |
B et I
Dans la fenêtre 'Graphiques' (menu
Fenêtre/graphe Variables), clic-D pour choisir 'Coordonnées' dans le menu contextuel, ou
clic-G sur l'icône correspondante
|
On a ainsi la représentation graphique de B=f(I).
2. exploitation
Observer que, comme avec d'autres formes de bobines, le champ magnétique est proportionnel à l'intensité (le coefficient de proportionnalité dépendant des caractéristiques géométriques du bobinage et de la perméabilité magnétique du milieu).
B. Étude avec un enroulement double (n = n2 = 2* n1)
F On veut étudier ici l'influence du nombre de spires par mètre.
Les autres paramètres (l, x) sont sans changement.
1. création et transfert d'une nouvelle page d'acquisition
Il suffit de recommencer la même étude qu'avec l'enroulement simple, mais lors de la demande de transfert, il faut choisir "Nouvelle page" dans la boîte de dialogue de transfert qui s'ouvre.
2. comparaison des pages; étude de B=f(n)
| Passer dans Regressi en mode "Superposition de pages" (clic-D pour
choisir "Coordonnées" ou "Options |
| Comparer (curseur "Réticule" dans la liste déroulante, avec frappe de la barre d'espace pour "marquer" le graphe) pour une même valeur de I les valeurs obtenues pour B, avec l'enroulement simple ou double: on découvre ainsi la proportionnalité du champ magnétique au nombre de spires par mètre n. |
3. synthèse: modélisation de B=f(I,n) et détermination d'une valeur expérimentale de µ0
| Créer le paramètre de page n (clic-D sur la fenêtre "Grandeurs" pour choisir "Paramètre expérimental", puis saisir dans l'onglet "Paramètres" la valeur de n pour chaque page | |
| Dans la fenêtre 'Graphiques', clic-D pour choisir 'Modélisation' dans le menu
contextuel, ou clic-G sur l'icône correspondante |
![]()
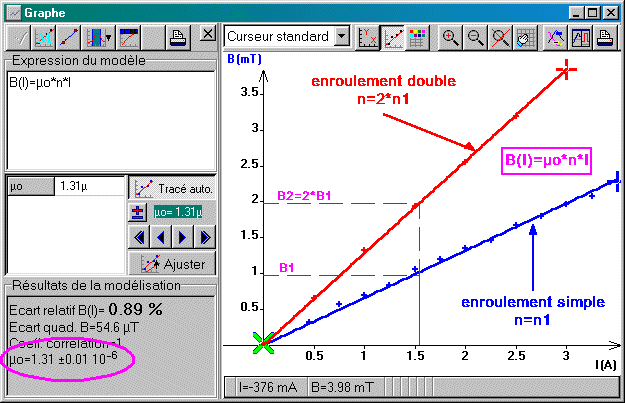
On obtient ainsi directement la valeur expérimentale de la perméabilité magnétique du vide par modélisation!
On peut utiliser en place de saisie manuelle des modèles prédéfinis(1) (accès par clic-G sur icône correspondante). Demander éventuellement au logiciel d'ajuster (clic-G sur le bouton "ajuster"
) le modèle à la courbe expérimentale en calculant la valeur des paramètres figurant dans l'équation du modèle.
N.B. L'ajustage est automatique dans le cas du modèle affine, si ce choix a été coché dans l'onglet 'Modélisation' du menu 'Options'.
| Passer à la page suivante (touche F8) et cliquer simplement sur le bouton "Ajuster" pour appliquer le modèle courant et obtenir un nouveau calcul de µ0. |
VII Étude similaire avec d'autres types de bobines
Les mêmes études peuvent être reprises avec d'autres géométries de bobines: on envisage par exemple ci-dessous le cas des bobines de Helmholtz (simples ou doubles):
A. Acquisitions
Étude topographique B = f(x) du champ à intensité
constante:
|
| Étude en fonction de l'intensité au centre du système |
B. Vérification du théorème de superposition des champs magnétiques
| Réaliser l'étude topographique B = f(x) séparément avec chacune des deux bobines, mais en prenant à chaque fois l'origine des coordonnées x au point central du dispositif complet | |
| Transférer chaque acquisition dans des pages séparées du même fichier | |
| Créer alors une nouvelle page dite "Page calculée" (menu principal "Pages / Calculer") et choisir "Somme" dans la boite de dialogue "Création d'une page calculée" qui s'ouvre: dans la nouvelle page créée automatiquement, on observe la superposition par simulation des champs créés indépendamment par chacune des deux bobines | |
| Il n'y a plus qu'à réaliser l'acquisition et le transfert dans une
nouvelle page de B = f(x) avec le dispositif complet (2 bobines) pour
pouvoir comparer le résultat expérimental avec la simulation, et valider ainsi le
théorème de superposition des champs magnétiques.
retour sommaire chapitre en cours |
![]()