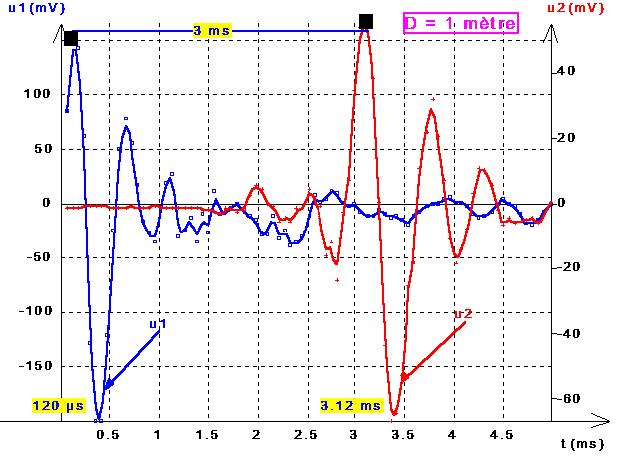CÉLÉRITÉ DU SON: MESURE DIRECTE
![]()
I Objectifs
II Montage, acquisition et transfert
III Exploitation: célérité du son dans l'air
IV Propagation dans un liquide ou un solide
![]()
I Objectifs
|
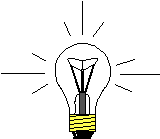 |
II Montage, acquisition et transfert
On étudiera dans cette partie uniquement la propagation dans l'air.
A. Principe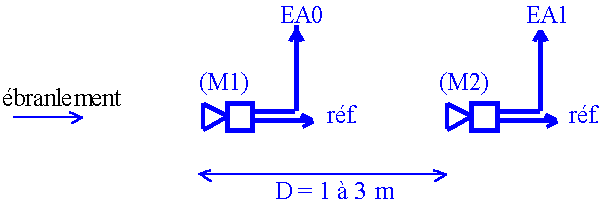
Deux microphones (M1) et (M2) étant écartés d'une distance D, un claquement sec produit dans leur alignement, devant le premier micro, se propage jusqu'au deuxième: on enregistre pendant ce temps les signaux captés par les deux micros, pour pouvoir les observer en concordance des temps dans Regressi. La comparaison des parties homologues des deux signaux permet de mesurer sur l'enregistrement la durée de propagation du signal entre les deux micros et d'en déduire la célérité.
B. Dispositif d'étude et précautions à prendre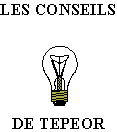 |
|
Il faut par ailleurs éviter le plus possible:
| les réflexions parasites sur les objets ou surfaces (le plan de travail, les cloisons, le plancher, etc.) avoisinants l'expérience | |
| la propagation du son par le plan de travail commun aux deux micros (isoler phoniquement leurs pieds par de la mousse absorbante) |
La durée d'enregistrement choisie doit correspondre à un peu plus que celle de propagation du signal , et doit donc être modifiée en fonction de la distance D (ici 1 m) pour améliorer la précision des mesures. On peut utiliser au choix comme signal de synchronisation:
| Un seuil de tension (assez bas) sur le signal du premier micro, avec une pré acquisition de l'ordre de 20%; cela quelle que soit la claquette utilisée. Le déclenchement de l'acquisition se fera alors à l'arrivée du signal montant sur le premier micro | |
| Un signal 'Front' envoyé sur l'entrée front EF0 au moyen d'un contact électrique; il faut alors en munir la claquette. Le déclenchement se produira alors lors de l'émission du bruit par la claquette, c'est-à-dire de façon légèrement anticipée par rapport à la méthode précédente. |
Choisir dans tous les cas un mode de déclenchement 'monocoup' sans lequel tout bruit intempestif (voix, etc.) risque de déclencher le balayage.
Le seuil de déclenchement (cas de la synchro seuil) doit être réglé
empiriquement car il dépend de l'amplitude du signal fourni par les micros: faire
plusieurs essais, sans perdre patience!
Abscisse: |
Voies actives: |
Enregistrement: |
Déclenchement (synchro): |
|||||
Temps |
EAx: |
Variable: |
Signe: |
Cal: |
Unité: |
Nombre points: |
Durée: |
Front sur EF0 Seuil: EA0 10 mV |
|
t |
EA0 |
u0 |
± |
200 |
mV |
100 |
5 ms |
|
EA1 |
u1 |
± |
100 |
mV |
||||
* avec ORPHY-GTS 2: la synchro seuil n'est possible que sur la voie EAD1 (entrée différentielle): il suffit donc de remplacer dans les indications précédentes (schéma et réglages) EA0 par EAD1.
* avec Orphy PORTABLE 2, brancher: deux capsules ±100 mV (ou bien 2 capsules Micro-son) et une capsule Synchro ("Seuil" pour l'air, ou "Front" pour un solide).
Charger les réglages d'acquisition:
| *
pour Orphy GTI2: |
* cas de l'air | * cas d'un solide |
| *
pour Orphy USB ou PORTABLE 2: |
* cas de l'air | * cas d'un solide |
| *
pour Orphy GTS2: |
* cas de l'air | * cas d'un solide |
D. Protocole d'acquisition
Le claquement déclenche l'acquisition; recommencer jusqu'à obtenir un enregistrement satisfaisant, c'est-à-dire dans lequel on puisse identifier facilement les parties correspondantes du signal sur le deux voies (ex: premier maximum)
E. Variables transféréesÄ t, u0, et u1.
Dans la fenêtre 'Graphiques' (menu Fenêtre/graphe Variables),
cliquer-D pour choisir 'Coordonnées' dans le menu contextuel, ou cliquer-G sur l'icône
correspondante ![]() pour vérifier que l'on a:
pour vérifier que l'on a:
| t en abscisses | |
| u0 en ordonnées (à gauche) et y ajouter: | |
| u1 en ordonnées à droite puisque l'échelle correspondante est différente (calibres différents lors de l'acquisition) |
On a ainsi la représentation graphique de u0 = f(t) et u1 = g(t). On peut déjà visualiser le décalage temporel entre ces deux grandeurs, et remarquer leur similitude.
Ä il est préférable de demander aussi lors du transfert celui du paramètre D après l'avoir indiqué dans la boîte de dialogue du transfert (si celle-ci offre cette possibilité), avec sa valeur dans chaque page d'acquisition.
III Exploitation: célérité du son dans l'air
A. Mesures graphiques et calcul de la célérité
Un clic-G sur l'icône ![]() d'identification des courbes(1) affiche automatiquement leur
signification en légende sur le graphique. La position de ces légendes et des flèches
correspondantes peut être modifiée par cliquer-glisser du pointeur quand il se
transforme en 'main' au survol des zones 'sensibles'.
d'identification des courbes(1) affiche automatiquement leur
signification en légende sur le graphique. La position de ces légendes et des flèches
correspondantes peut être modifiée par cliquer-glisser du pointeur quand il se
transforme en 'main' au survol des zones 'sensibles'.
Prendre le 'curseur données' pour déterminer sur le graphique le décalage temporel
entre les deux signaux: dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, choisir u0 et u1
pour les curseurs 1 et 2, cocher les choix 'abscisse' et 'écart' pour leur affichage, et
valider. Cliquer-glisser le pointeur pour amener le premier curseur à un point choisi de
la courbe (1), puis cliquer-glisser à nouveau pour amener l'autre curseur sur le point
correspondant de la courbe (2). On lit alors directement la valeur de D t cherchée
sous forme d'une barre horizontale apparue sur le graphique.
La célérité se déduit alors par sa formule de définition: v = D / D t; ce qui donne par exemple ici:
V = 1 / 0.003 = 333 m/s
B. Influence éventuelle de la distance de propagation
Il suffit de faire la comparaison de différentes pages d'acquisition obtenues avec des valeurs différentes de la distance D entre les deux micros, 2 mètres, 3 mètres par exemple. Le logiciel d'acquisition étant ouvert, il faut lui 're donner la main' en cliquant sur l'icôneAprès traitement dans Regressi, on montre ainsi que la célérité ne dépend pas de la distance parcourue. On va donc achever de montrer maintenant que c'est une caractéristique du milieu de propagation.
C. Influence des caractéristiques physiques du gaz
L'incidence de la température peut être testée en plaçant l'air chauffé (avec un séchoir à cheveux) dans un tube en plexiglas, à l'intérieur duquel pénètrent les micros, à l'aide de joints étanches et phoniquement isolés.IV Propagation dans un liquide ou un solide
La même étude que précédemment peut être à nouveau menée moyennant un aménagement:
| des réglages d'acquisition (durée de propagation beaucoup plus petite) | |
| du dispositif d'émission du son qu'il faut adapter aux nouveaux milieux de propagation utilisés | |
| de la synchronisation choisie pour le déclenchement du balayage. |
A. Dans les solides
Le milieu de propagation est constitué par exemple d'une tige droite d'acier, ou de fer, de 1 mètre de longueur environ (telle que celle utilisée dans les supports verticaux de matériel), dans laquelle on va étudier cette fois la propagation d'un signal transversal. Les boules des deux microphones sont appliquées sur une génératrice de la tige, près de chacune de ses extrémités. Des essais devront être faits pour régler le niveau des calibres des deux voies
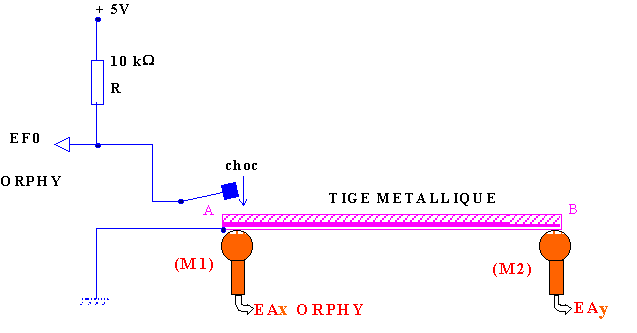
L'ébranlement est produit par la percussion latérale d'un objet métallique (ex: maillet) sur l'extrémité (A) de la tige. On peut ainsi déclencher le balayage:
|
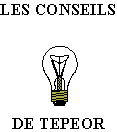 |
La durée du balayage doit être sensiblement réduite par rapport au cas de l'air pour tenir compte de l'ordre de grandeur beaucoup plus élevé de la célérité dans les solides.
B. Dans les liquidesLa rétention du liquide utilisé peut être assurée:
| par un tube en plexiglas de grand diamètre, d'axe disposé horizontalement | |
| ou, mieux, une grande cuve (aquarium par exemple), ce qui éloigne de la zone de propagation utilisée (celle qui est située entre les deux micros) les parois solides susceptibles de transmettre l'ébranlement à une autre vitesse. |
Un sachet plastique mince enveloppant chaque microphone évite la pénétration d'eau à l'intérieur, au prix d'une légère atténuation de l'intensité sonore. Dans la solution 'tube', un trou percé latéralement dans la génératrice supérieure du cylindre permet le passage de chaque microphone sans entraîner de fuite du liquide.
retour sommaire chapitre en cours
![]()
(3) si le module de raccordement pour Orphy est utilisé, il faut impérativement que son interrupteur déclencheur (situé dans la zone 'synchronisation') soit en position neutre, sinon le potentiel de EF reste en permanence à 0 V!